

 |
 |
PHYSIOLOGIE ET SOPHROLOGIE
 |
Le neurone |
| Le Parasympathique ralentit les fréquences cardiaque
et respiratoire. Les vaisseaux coronaires se contractent, de même
que la musculature lisse de l'arbre bronchique. La sécrétion
glandulaire et le péristaltisme intestinal sont stimulés.
L'action du parasympathique provoque la vidange de la vessie et du rectum,
la dilatation des artères du bassin et l'érection.
Dans l'oil, le parasympathique détermine l'accommodation et le rétrécissement
de la pupille (myosis).
Le sympathique lui, accélère la fréquence cardiaque et respiratoire. Il dilate les vaisseaux coronaires et les bronches. La musculature des petites artères se contracte. La tension artérielle augmente. La sécrétion glandulaire, le péristaltisme intestinal, la vidange de la vessie et du rectum sont inhibés. L'éjaculation est sous la dépendance du sympathique. Dans l'oil, celui-ci provoque l'élargissement de la pupille (mydriase). Les plexus nerveux autonomes dans le thorax, l'abdomen et le bassin sont parcourus par des fibres nerveuses parasympathiques et sympathiques. Par les ébranlements qui lui parviennent de
l'environnement, le système nerveux reçoit l'empreinte du
monde extérieur et s'en trouve informé.
De même, il est averti des événements
intérieurs à l'organisme.
|

Schéma général du système
nerveux cérébro-spinal
| Dans les deux cas, le cycle nerveux s'accomplit
fonctionnant selon un principe de rétroaction.
C'est-à-dire «qu'à un phénomène
extérieur d'impression, succède un phénomène
intérieur de sensation, qui suscite un nouveau phénomène
extérieur de reprise à l'impression (action réflexe),
lui même, suivi d'un nouveau phénomène de sensation,
qui enregistre, intègre la réponse accomplie».
(Précis de Physiologie - H. Hermann - J.F. Cier - Edition Masson).
Ce mode de fonctionnement confère, à
l'être humain son individualité qui s'exprime par la
conscience, la mémoire, l'instinct
et l'intelligence. La conscience, nous
ne la saisissons qu'en nous-même. Elle nous permet de distinguer
notre moi de ce qui l'entoure, c'est-à-dire les sensations imprécises
provenant de nos organes, de tout ce qui nous assaille de l'extérieur
dans sa composition, sa forme, son déplacement, ses qualités.
|

Le système nerveux végétatif
| A chacune des sensations fait suite la série concordante des
actes psychiques, jusqu'à ce que l'habitude rende ces opérations
inconscientes.
L'automatisme réduit alors la délibération à la seule impulsion directrice éclairée par la conscience. Les sensations sont les processus les plus élémentaires du champ de conscience. Elles se divisent en trois catégories : a)
Les sensations proprioceptives
b)
Les extérocepteurs
c)
Les viscérocepteurs
Les neurones donc, reçoivent
des excitations et les transmettent par l'influx nerveux, par l'intermédiaire
d'autres neurones situés dans les cornes postérieures de
la moelle, et ceux du tronc cérébral.
Une stimulation ou une action peut donc se faire
sur la conscience par l'intermédiaire des récepteurs et des
analyseurs et plus particulièrement, par l'intermédiaire
des muscles et des organes internes.
Le système nerveux, en particulier le système
nerveux central, est un système fonctionnel complexe, lieu de convergence
des informations et des signaux, qu'il traite, sélectionne et analyse.
* La formation réticulaire : Située au sein du tronc cérébral,
c'est seulement en 1944 que Mougoun a montré le rôle
considérable de la formation réticulée. Parfois
appelée le 3ème cerveau, son rôle est
non seulement de maintenir le niveau de vigilance, mais d'assurer
aux structures une excitabilité optimale, selon les différentes
actions à accomplir.
La formation réticulée fonctionne par activation ou désactivation, c'est-à-dire que : Elle peut être activée
:
Cette activation permet à l'ensemble des structures nerveuses de s'adapter à une activité accrue de l'organisme, qui prend la forme d'une élévation du niveau de conscience, des niveaux de vigilance. Ce qui facilite la motricité. Elle peut être désactivée
:
La formation réticulaire est
donc un agent harmonisateur, équilibrant les différents
systèmes de notre organisme :
Les méthodes sophroniques abaissant le tonus
musculaire contribuent à rendre optimale son activité.
Les techniques sophroniques permettent à chacun de nous de contrôler notre vigilance par l'intermédiaire de cette activation ou désactivation de la formation réticulée.* Le cerveau viscéral |
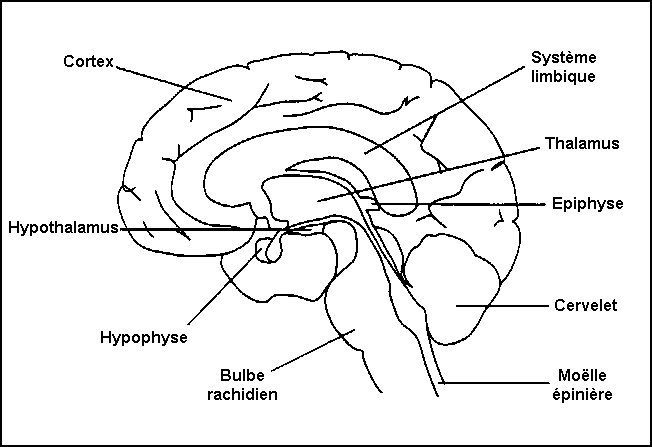 |
|
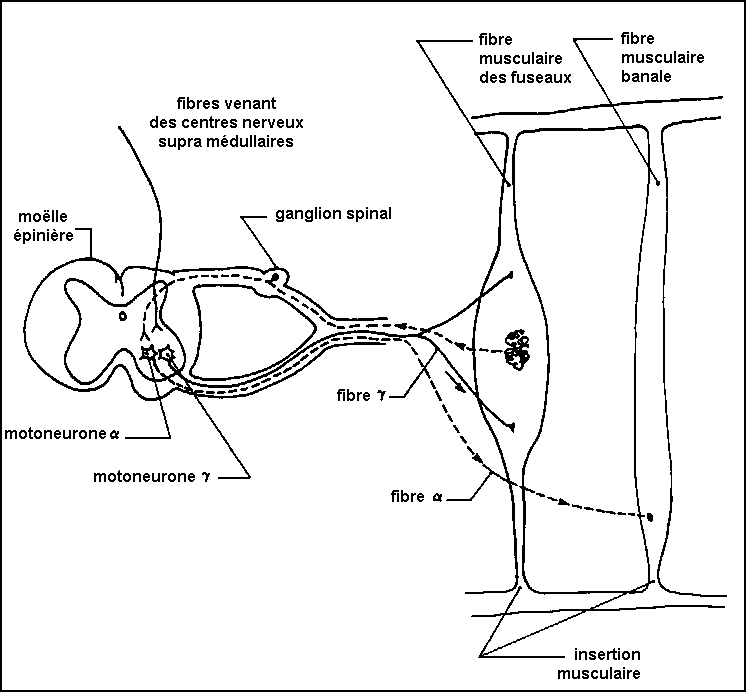 |
|
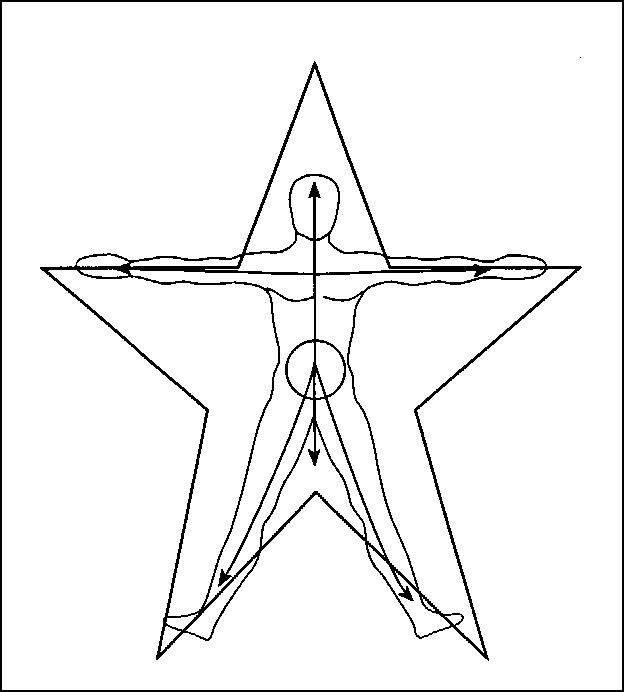 |
et la circulation de l'Energie |
| La Sophrologie par l'intermédiaire
de la phénoménologie est un bon moyen pour étudier
les phénomènes liés au conditionnement.
L'action du sophrologue par le Terpnos logos
est une stimulation faible, monotone qui inhibe les centres nerveux
du système auditif. La relaxation qui en découle,
entre autre musculaire, élimine de manière massive toutes
excitations en direction du cortex, aidé en cela, par l'action du
sujet relaxé.
D'autres règles employées lors du conditionnement
peuvent être appliquées au phénomène de sophronisation,
telles par exemple:
On peut aussi constater que les techniques sophroniques, au cours de l'entraînement sophronique, utilisent la réaction conditionnelle. Un entraînement amène le sujet à
une relaxation rapidement sans passer par toutes les étapes intermédiaires.
C'est parce que le sujet a acquis au cours de cet entraînement,
une attention, une concentration, qu'il peut se détacher des bruits
environnants et enregistrer seulement les stimuli positifs tels la voix
du sophrologue et ses suggestions le relâchement de ses muscles,
la musique apaisante.
L'être humain subit et crée des conditionnements depuis son plus jeune âge. La plupart du temps, l'éducation complique et tente d'affiner par l'instauration parfois de carcans (psychiques) les pulsions primitives. Tout est dans le savoir vivre et la retenue. L'expression, donc, des sentiments «se retient dans son élan». Le conditionnement se manifeste aussi dans la vie
végétative, dans l'ordonnancement des repas et les horaires.
Plus l'être humain devient adulte, et plus le conditionnement doit
s'effectuer à son insu, sans qu'il soit conscient de celui-ci.
Plus l'enfant grandit et plus la généralisation sémantique prend le pas sur la généralisation phonétique. Les mots permettent alors de manier à notre guise les objets quand ils sont absents. Les mots usuels très utilisés sont renforcés de ce fait, de même pour les associations verbales. Ne nions pas, que même si nous associons un sens différent au mot exprimé, les opinions les plus personnelles ont toutefois subi l'empreinte du conditionnement familial ou social. D'ailleurs, le phénomène de généralisation atteint aussi le langage. En fait, plus les stimuli se rapprochent du stimulus original, plus ils sont efficaces et provoquent la réponse conditionnelle. Markosian (1957) effectua une expérimentation chez l'homme, mettant en évidence ce phénomène: Par le seul son du métronome précédé d'un choc électrique, il établit une réaction conditionnelle l'accélération de la coagulation du sang. Puis il remplace le métronome par la prononciation du mot «métronome» et constata la persistance de la RC. Puis il substitue au mot «métronome» celui de «métropole» et observa également la RC. mais moindre. Ensuite, il utilise le mot «microscope» en remplacement du mot «métropole» et met en évidence la même RC. mais amoindrie. La parole survient donc comme 2ème élément
de signalisation.
Ceci grâce aux analyseurs corticaux. Certains d'entre-nous sont conditionnés par stéréotype c'est-à-dire ils subissent en quelque sorte une chaîne de conditionnements successifs toute la journée et même si un élément de cette chaîne est absent, le conditionnement est toutefois actif. Ce sont par exemple : des actions effectuées à intervalles réguliers tout au cours de la journée, même si celles-ci entraînent des réactions différentes. Toutefois, un conditionnement ne s'installe pas sans une motivations fondamentale. Le besoin et la motivation sont étroitement liés et parfois la motivation peut être un élément renforçateur du conditionnement. Plus la motivation est importante et moins
le sujet discrimine le stimulus opérant.
Les motivations primaires liées au besoin sont la faim, la soif, le sommeil, l'instinct sexuel, certains besoins physiologiques etc.. Il existe cependant, d'autres motivations (dites
secondaires) qui incitent à agir, tel par exemple, le besoin de
dormir ou de manger à heure fixe, qui auront donc une influence
sur la motivation primaire : la faim ou le sommeil. Quoi qu'il en
soit, l'élément déterminant du conditionnement: c'est
le renforcement N'oublions pas que même le manque
de stimulations engendre une motivation.
En fait, ce qui est primordial, c'est de développer au mieux notre potentiel en élargissant le champ d'action de nos facultés. Nous pouvons opérer des conditionnements et des déconditionnements conscients avec l'accord de notre inconscient, c'est-à-dire lors d'exercices de visualisation créatrice par exemple : si vous désirez vous suggestionner positivement, mais que vous n'en êtes pas profondément convaincu. ou encore, si vous visualisez une situation mais que votre visualisation ne correspond pas à un besoin réel, vos tentatives dans les 2 cas sont vouées à l'échec, car vous êtes en désaccord avec les conditionnements préalables. C'est pourquoi, il est nécessaire de purifier votre psychisme c'est-à-dire d'analyser l'origine de vos conditionnements. Si vous avez subi des traumatismes au cours de votre
vie ou dans votre enfance, des comportements inhibiteurs en découleront.
Cette zone d'ombre en vous, si vous ne l'amenez pas à la lumière
de la conscience, sera toujours la marge d'inconnu et de non pouvoir, de
non-maîtrise sur vous-même. Appliquez-vous
donc à faire des actes consciemment comme respirer par exemple :
afin de favoriser en vous la création d'automatismes plus adéquats.
C'est au cours d'une élaboration progressive que l'on a pu développer cette notion de schéma corporel. Depuis le 19ù siècle, de nombreux chercheurs ont créé leur propre terme pour définir plus que la perception des sensations provenant des différentes parties du corps qui sont transmises aux centres nerveux. Si le premier à penser que chacun possédait en soi une configuration topographique de son corps fut le neurologue François Pierre Bonnier - Jean l'Hermitte parle d'image du moi corporel et Wallon de conscience du corps propre, en élargissant cette notion de schéma corporel. |
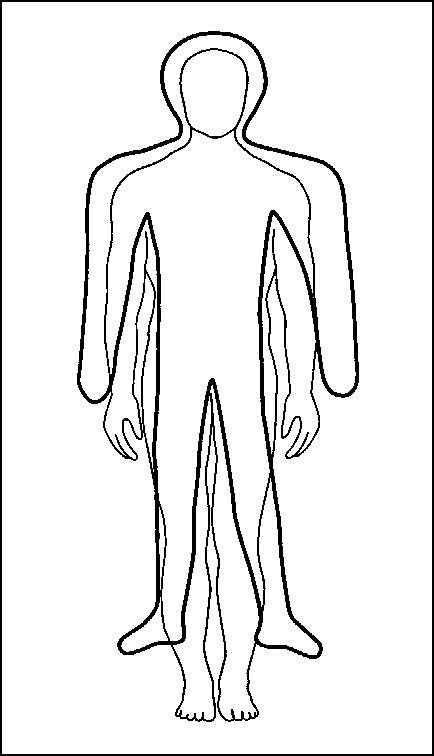 |
En filet maigre : le Corps Idéal |
| En Occident, nous nous sommes intéressés
au langage corporel que comme à un comportement varie à deux
sortes d'expressions :
- l'expression de l'art (danse, mime etc...) - le langage de la maladie qui traduit dans et par le corps, les crises psychiques. Les bien-portants oublient leur corps parce qu'ils ne le ressentent pas assez pour l'écarter. Par contre, chez les malades, l'attention portée au corps est décluplée, traduisant de manière plus évidente le clivage entre le corps et l'esprit. L'adolescence par exemple, est l'âge où les conflits psychiques et culturels se jouent entièrement dans la relation à l'environnement. Combien d'adolescents se trouvent trop gros ou trop maigres, essayant de modifier leur apparence à l'aide de régimes souvent fantaisistes ou draconiens qu'ils ont le plus grand mal à respecter. Ils alternent des périodes de refus de la nourriture avec des phases de fringale ou même de boulimie. L'anorexie mentale par exemple : apparaissant entre 15 et 18 ans essentiellement chez les adolescentes, se rencontre aussi, toutefois de plus en plus chez les garçons anorexiques. La thérapie des anorexiques nous apprend qu'elles rejettent les transformations pubertaires de leurs corps et souhaitent retrouver une apparence d'enfant. Ce qui est en cause, c'est d'abord une incapacité à assumer le rôle sexuel génital et à intégrer les transformations de la puberté, mais surtout un conflit au niveau du corps qui est refusé et mal traité. L'origine de l'anorexie serait à rechercher dans la petite enfance : le nourrisson aurait appris à répondre exclusivement aux sensations et besoins corporels de sa mère et non aux siens ; il ne parviendrait donc pas à identifier les besoins de son propre corps, ce qui expliquerait à l'adolescence la distorsion «délirante» de l'image du corps avec déni de l'amaigrissement et crainte durable d'être laide et grasse. La conception du stade du miroir apporte des lumières sur la fonction du "JE". Le petit d'homme reconnaît son image dans le miroir dès l'âge de 6 mois. Il s'agit de comprendre le stade du miroir comme une identification. C'est-à-dire la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. L'assomption jubilatoire de son image spéculaire par l'enfant, encore plongé dans sa dépendance motrice et de nourrissage, paraît manifester la matrice symbolique ou le "JE", forme primordiale, s'objective par la suite en une dialectique mettant en jeu l'identification à l'autre. C'est par le langage que l'enfant retrouve sa fonction de sujet. Bien sûr, nous parlons ici du "Je" idéal. La fonction du stade du miroir s'avère pour
les psychanalystes (Lacaniens). « un cas particulier de la
fonction de l'image qui est d'établir une relation de l'organisme
à sa réalité .... » Mais cette relation
est altérée chez l'homme comme par une discordance primordiale
qui trahit les signes de malaise et l'incoordination motrice des mois néonataux.
Pour Lacan, le stade du miroir est «un drame dont la poussée interne se précipite de l'insuffisance à l'anticipation et qui pour le sujet, pris au leurre de l'identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d'une image morcelée du corps..... » (Les écrits de Jacques Lacan - Editions du Seuil). Le corps morcelé se montre régulièrement dans les rêves ainsi que dans le test de Rorschach, sous la forme de membres disjoints et d'organes «en souffrance». Evoquons les diverses images du corps dans les grandes organisations psychiques: corps morcelé, envahi ou tout puissant du psychotique, corps en mosaïque (ou avec une vacuole) de l'état - limite, corps phallus de certaines organisations narcissiques et caractérielles, corps déshabité, désinvesti dans les dépersonnalisations, secteur du corps ? et autonome du psychosomatique, corps expressif, corps fantasme de l'hystérique. Apprenons à connaître le sens symbolique et hiérarchique de notre corps
- Le bassin et le ventre: ils sont le centre
de gravité de notre corps, de nos fonctions premières et
de leurs pulsions, procréer, subsister.
«Nos gestes, écrit Yvonne Berge, sont le symbole de nos refoulements et de nos crains, alors qu'ils devraient traduire ce que nous avons envie de faire partager: nos émotions les plus essentielles». (Vivre son corps par Y. Berge - Paris - Le seuil - 1975). Le schéma corporel s'élabore progressivement mais aussi par l'intermédiaire de facteurs physiologiques, affectifs et sociaux. |
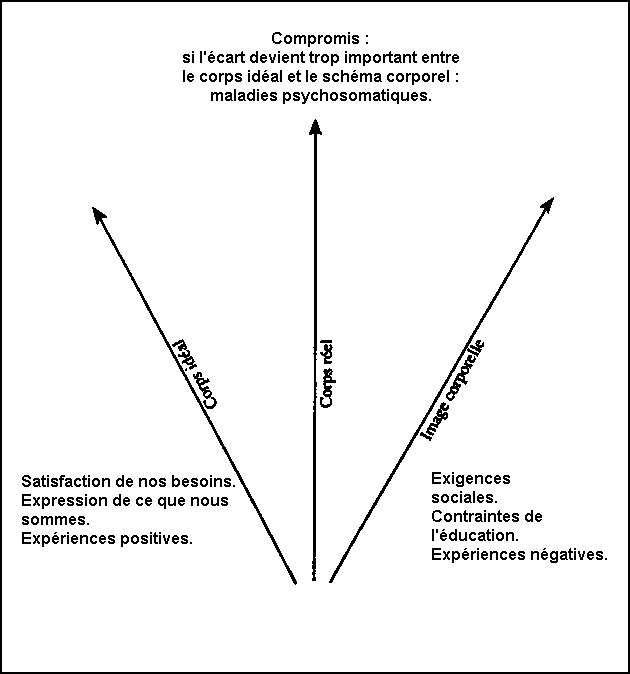
| Dans la perspective psychanalytique, certains auteurs
tel Schilder, insistent sur le rôle joué par les différentes
zones érogènes: buccale, anale, génitale dans la constitution
de ce schéma.
En signifiant la place de l'identité sexuelle, dans cette constitution. Schilder par ailleurs, insista sur le fait que chez l'enfant «activité sensori-motrice et réactions affectives sont constamment liées». Il ajoute que la douleur serait un des éléments constituteur de cette image du corps. L'équipe de l'institut de Marcel Rivière à la Verrière, dirigée jusqu'en 1972 par le professeur P Swadon, aide à la reconstitution du schéma corporel en reprenant de zéro les gestes qui ont marqué la lère' histoire de notre corps. En premier lieu, le geste raconte
Remontons le fil de cette histoire : c'est parce
que l'enfant (vers 5-6 mois) reconnaît d'abord ses parents dans le
miroir avant de se reconnaître lui-même, que nous accompagnons
toujours l'appréciation de notre corps d'un jugement de valeur.
Ce jugement de valeur, nous l'attribuons à autrui, mais en fait,
il n'est que le reflet de ce que nous pensons de nous car bien entendu,
la famille, les amis, le groupe social dans lequel nous vivons est nourri
d'opinions sur la question: «La beauté», qui va servir
de modèles d'identification voire d'imitation, pour l'enfant.
«Le nouveau-né ne distingue pas son
corps. Jusqu'au sixième mois, ses mains et ses pieds lui apparaissent
comme des objets étrangers. L'enfant n'a qu'une vision partielle
de son corps, celle des organes ou membres que ses yeux lui permettent
d'apercevoir. C'est pourquoi se regardant dans une glace, l'enfant
de sept mois cherche dans un premier temps à saisir l'image qu'il
voit». (M. Bernard : «le Corps»
- Paris - Editions Universitaires, 1974).
Le schéma corporel, structure
permanente, plus ou moins en cours d'ajustement dynamique, permet à
l'individu de façon plus ou moins consciente :
Tout individu n'a pas, malheureusement, une image unifiée de son corps en particulier les psychotiques qui éprouvent de vives angoisses suite à des sensations de morcellement mais aussi, certaines personnalités (Narcissiques) qui ont subi de nombreuses opérations et qui possèdent une image «en rupture» de l'intérieur de leur corps. Dans son livre «Vocabulaire de la Psychologie» (Paris - PUF - 1957) Henri Pieron avance que le schéma corporel «est la représentation que chacun se fait de son corps et qui lui permet de se repérer dans l'espace». Or une partie du schéma corporel vient du geste. Les schémas de gestes, de postures, de sensations, tout le vécu interne plus ou moins imaginaire qui nous sert de référence, d'orientation générale se constitue par rapport à l'autre, au départ la mère. C'est l'oil de l'autre qui nous fait laids ou beaux, d'où l'importance capitale de la façon dont nous avons été manipulés, des gestes qui ont été faits pour ou contre nous. Quand il y a dissociation entre ce que nous sentons dans notre corps et ce que les autres voient, surgit le délire. - P. Debray Ritzen avance dans son livre «la Psychologie de l'enfant de A à Z» (Paris - Retz - 1976) que «la destruction de certaines zones du cerveau, entraîne même une totale négligence ou ignorance de la partie du corps intéressée, et qu'inversement l'amputation d'un membre est sentie de la perception erronée d'un membre fantôme et de pseudo-sensations à son niveau en raison de la persistance de la zone cérébrale où s'est construite «l'image» de ce membre». Nous savons à présent que le schéma corporel peut être modifié ou achevé lors de certaines maladies : en particulier les maladies provoquant des lésions cérébrales qui empêchent donc le malade d'ajuster ses sensations à l'image qu'il perçoit de son corps. Les blessés de guerre en sont un autre exemple.
Car ils conservent même après l'amputation du membre blessé,
les sensations liées à ce membre.
La Sophrologie a pour fonction de contribuer par des exercices appropriés à aider le sujet à accepter un corps tel qu'il est - que ce corps soit amputé ou non. Son but est d'aider chacun de nous, à intégrer les modifications que peut subir ce corps : telle une grossesse par exemple, mais aussi à effectuer les mouvements plus facilement, plus aisément et à corriger certains troubles ou dysfonctionnements. Mais avant tout, sa première fonction va être de permettre au sujet de prendre conscience de son corps et des rejets inconscients qu'il manifeste à son encontre ; du clivage entre ce qu'il pense de ce corps , son potentiel et ce qu'il provoque chez autrui comme réflexions. La Sophrologie ouvre les yeux sur l'acceptation de ce corps tel qu'il est sans sentiment de dévalorisation de ce dernier. L'abord corporel (massages - exercices physiques)
permet au sujet de rétablir des relations plus rassurantes avec
le monde ambiant, il l'aide à se reconstruire en faisant par exemple:
des gestes simples de la vie, comme on fait des gammes.
Il s'agit de franchir cette étape afin
de retrouver la spontanéité harmonieuse des mouvements qui
vont participer à la reconstruction de l'unité psychosomatique
de notre être.
Notre organisme est un accumulateur-transformateur
d'énergie. Pour les Yogis, les principaux points d'absorption
de l'énergie subtile qui est l'air (le prâna)
sont: la peau, la langue, les alvéoles pulmonaires et les terminaisons
nerveuses des fosses nasales.
|
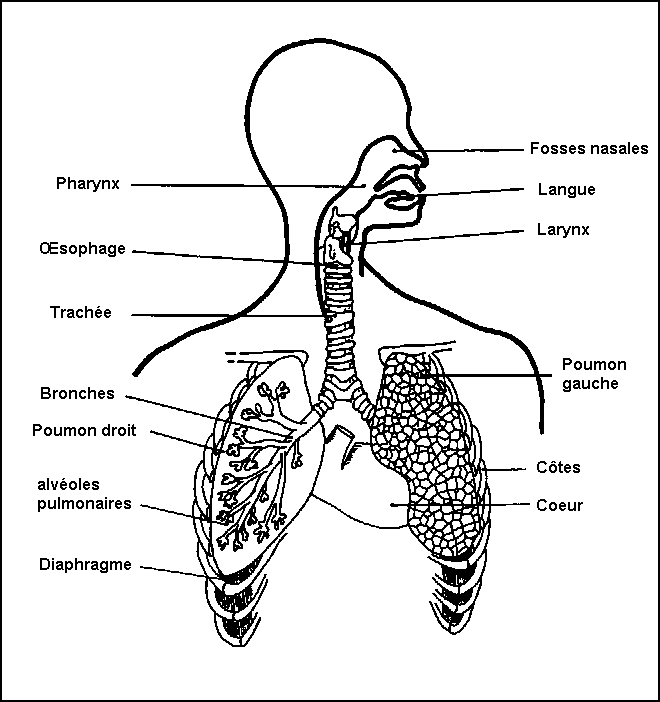 |
|
| En effet la peau absorbe et rejette le prâna.
La langue, autre point d'absorption du prâna ... est active dans la consommation d'aliments - Les aliments représentent une source d'énergie. Ils sont en fait le carburant permettant de faire fonctionner notre machine thermique : le corps. D'où l'importance de mastiquer lentement et consciemment. Le nez est le principal organe d'absorption de l'air. En faisant le calcul, on constate que notre nez livre le passage à plus de 13 000 litres d'air par jour. Le nez conditionne, à l'aide d'une infinité de récepteurs nerveux ultrasensibles, l'air inspiré, en le réchauffant, en l'humidifiant, en le débarrassant de ses poussières et de la plupart des microbes. De plus, il en discerne la qualité subtile grâce à l'odorat. Les parfums par exemple: sont porteurs d'énergie prânique et de bioélectricité. L'odorat ouvre une porte vers les couches psychiques profondes. Lors des méditations par exemple: on tient compte de l'influence de ses parfums: encens, bois de santal, etc... sur les concentrations. L'aliment premier de nos cellules, c'est l'oxygène. On ne peut se passer de respirer. C'est une fonction vitale et que pourtant la plupart d'entre nous, méconnaissent - C'est la seule sur laquelle notre volonté ait une action. |
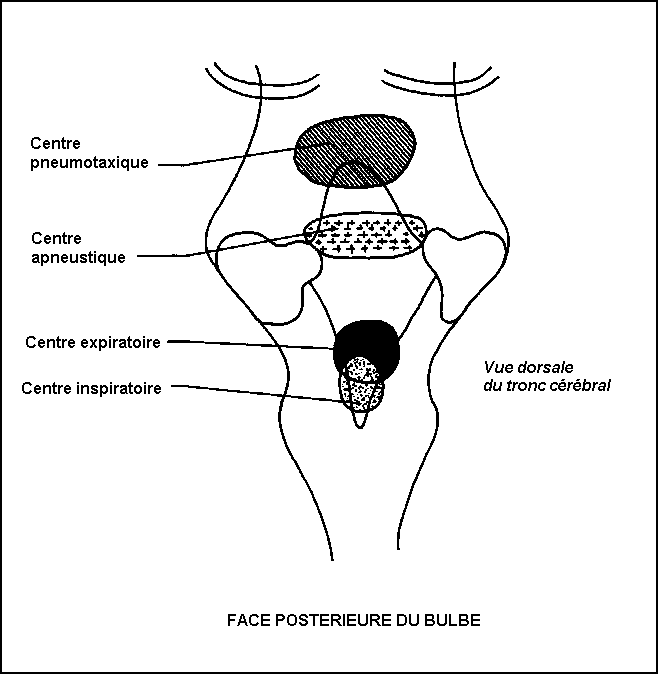 |
|
| Nous pouvons maîtriser notre énergie
vitale par la longueur du souffle, son rythme, sa durée, son amplitude,
sa relation avec chacune des activités du corps, de l'esprit, et
du psychisme. Il existe donc un grand nombre de techniques respiratoires
permettant d'acquérir la maîtrise du souffle. Nous n'en
citerons, bien sûr, que quelque unes issues d'origines diverses :
Yoga - exercices spiritualistes - sophrologie - etc...
ler exercice respiratoire «En position assise, détendez-vous ...
Relaxez-vous ... puis immobile ... Prenez conscience de votre souffle en
suivant le trajet de l'air pendant l'inspir long et profond, narines bien
écartées... Pendant l'expir qui doit durer longtemps, freiner
le débit de l'air, raccourcir ainsi la longueur du souffle... Prenez
conscience de la tiédeur de l'air qui sort des narines...
On reconnaît au «OM» prononcé
mentalement (et intérieurement) des effets psychiques et prâniques
plus intenses qu'au «OM» sonore.
2ème exercice respiratoire «Exercez-vous à déplacer la conscience le long de votre colonne vertébrale de bas en haut pendant que vous inspirez ... et de haut en bas pendant que vous expirez... Lors de l'inspiration... prononcez mentalement ou à haute voix... le mantra «SO» ... et pendant l'expiration «HAM»...» Le Mantra «SO-HAM» signifie:
je
suis cela.
3ème exercice respiratoire La respiration complète met en oeuvre 3 types
de respiration
Au début, il est conseillé de bien dissocier les 8 temps de cette respiration complète en procédant comme suit toujours dans l'ordre :
1 - respiration diaphragmatique
Lorsque le jeu des trois étages est assimilé,
cherchez à respirer simultanément avec ceux-ci sans perdre
de vue la qualité de chacun d'eux.
Au cours de l'expiration, la sangle abdominale jouera pleinement afin d'aider le diaphragme dans sa course remontante par l'intermédiaire des viscères abdominaux énergiquement repoussés. 4ème exercice respiratoire : (selon Caycedo) Relaxation Dynamique ler degré. «Tenez-vous confortablement debout, en position
orthostatique, les pieds légèrement écartés,
les genoux légèrement fléchis et fermez les yeux...
Penchez-vous en avant à partir du bassin
en retenant toujours la respiration aussi longtemps que cela vous sera
possible... Quand vous ne tiendrez plus, laissez le souffle littéralement
«exploser» de votre nez, en d'autres termes, chassez violemment
l'air en écartant les bras...
5ème exercice respiratoire - Pour améliorer votre rendement physique et psychique (selon le Dr ABREZOL). «Veuillez vous allonger sur le dos et poser
une main sur votre abdomen... Expirez à fond... Videz vos poumons
... Puis inspirez lentement par le nez, en emplissant, en premier l'abdomen
qui doit pousser votre main...
Une mauvaise respiration est la porte ouverte à
toutes sortes de désordres organiques : constipation, problèmes
génitaux, insuffisances biliaires et hépatiques, problèmes
digestifs, sanguins etc... Lorsque nous sommes sous tension c'est le diaphragme,
le muscle respiratoire qui sépare le thorax de l'abdomen, qui est
le plus souvent paralysé d'où l'importance de respirer abdominalement.
Il existe donc des exercices respiratoires pour activer, faciliter ou développer
la fonction d'un organe. Par exemple:
Appliquez-vous à élargir votre sensibilité et à ressentir cette respiration par et de tout le corps.
|
|
||
Copyright © 2001-2016 Sophro.Relax.BG